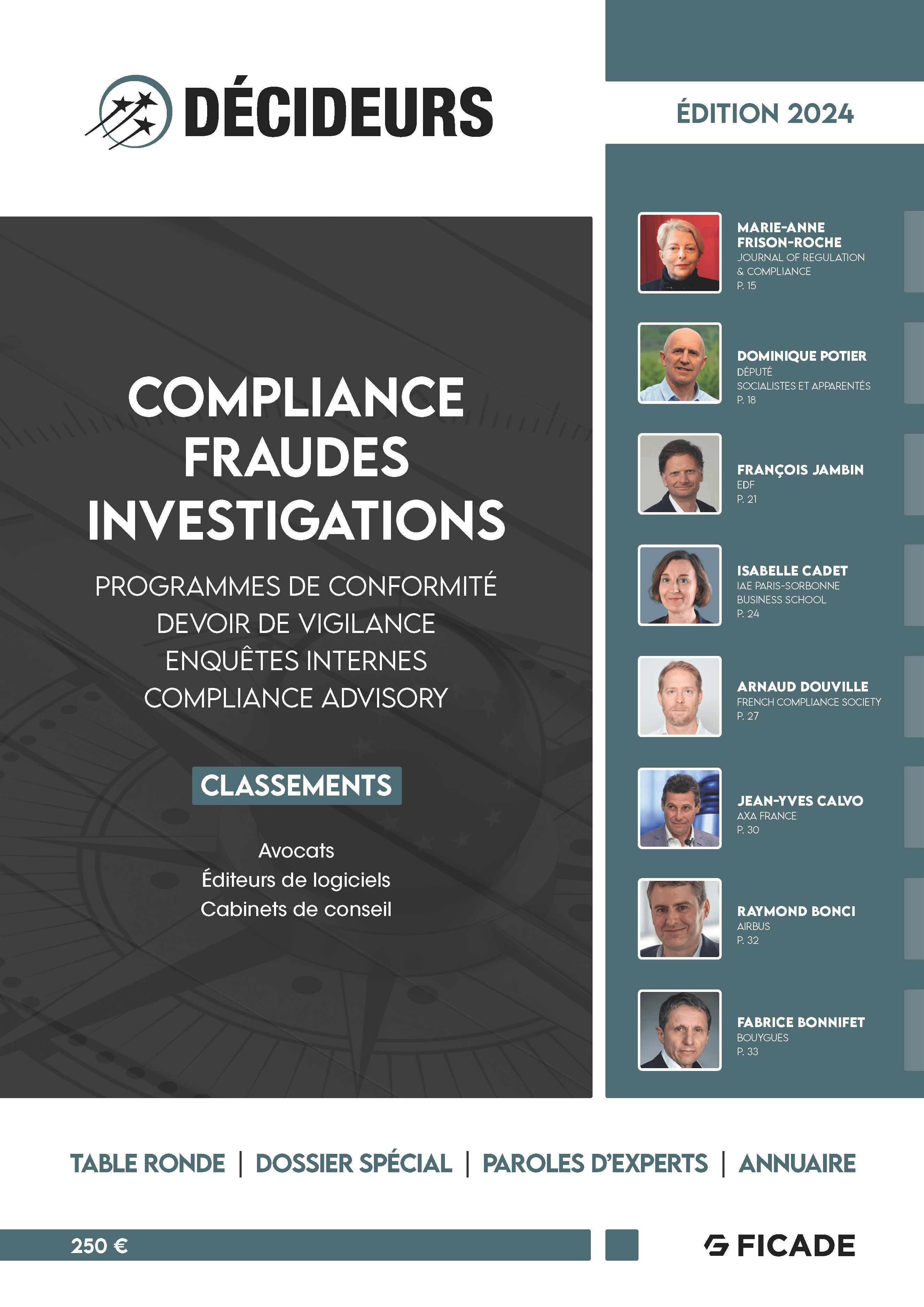Transaction pénale : la nouvelle arme du PNF
Payer une amende pour éviter un procès, voilà en substance ce que permet la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), abandonnée dans un premier temps pour être réintroduite au cours des débats parlementaires, et finalement réintégrée dans la loi Sapin II. Inspirée du deferred prosecution agreement américain, cette mesure a été critiquée de toutes parts, accusée d’offrir une échappatoire aux entreprises soupçonnées de fraude fiscale. Invitée à intervenir, le 7 avril dernier, lors d’une conférence du Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle (Ceifac), la procureure Éliane Houlette, à la tête du Parquet national financier (PNF) est revenue avec pragmatisme sur les intérêts du dispositif.
« La personne morale est une fiction juridique »
Car l’objectif de la CJIP est on ne peut plus pragmatique : viser les personnes morales, jusqu’à présent très rarement condamnées pour faits de corruption, ou alors pour des montants dérisoires. La procureure rappelle par exemple la sanction de Total dans le scandale Pétrole contre nourriture, condamné en 2016 par la cour d’appel de Paris à payer une amende de 750 000 euros pour corruption d’agent public étranger après plus de onze ans de procédure. « Mais quel est le poids d’une amende de 750 000 euros pour une entreprise comme Total ? », interroge Eliane Houlette. « La personne morale est une fiction juridique : on ne peut pas l’emprisonner. » Pour qu’elle ait du sens, la transaction pénale doit donc être à la fois plus rapide et impliquer une sanction pécuniaire significative. « L’amende doit avoir le caractère d’une sanction. » La publicité est aussi un volet important de cet instrument, qui n’a encore jamais été utilisé par le Parquet. Rendre publiques les négociations permet d’une part de lever les doutes des citoyens sur la transparence de la procédure ; d’autre part, de leur donner un caractère dissuasif.
Punir sans pénaliser
Aux États-Unis, la grande majorité des procédures pénales se règlent par la voie de la reconnaissance de culpabilité. Toutefois, la transaction pénale à la française ne prévoit pas cette reconnaissance. Une critique qu’Éliane Houlette balaie méthodiquement : « Un très grand nombre de sociétés françaises ont été condamnées de manière très forte, notamment par les autorités américaines. Or, une condamnation peut fermer les portes de certains marchés internationaux à ces entreprises. » Un rayonnement qu’il faut aussi avoir à l’esprit pour la procureure, qui rappelle que la France peine à conserver sa place de grande puissance mondiale. La transaction pénale a été voulue pour pouvoir condamner « pécuniairement et sévèrement » les entreprises soupçonnées de corruption, avec une amende dont le plafond a été fixé à 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers bilans connus à la date du constat des manquements. Pour une entreprise comme Total, citée plus haut, cela représenterait donc une amende maximale de 55 milliards de dollars[1] – une somme bien supérieure aux 750 000 euros auxquels elle a été condamnée. La transaction pénale permettrait-elle ainsi de punir sans pénaliser les fleurons français ? « Tout va dépendre de la manière dont le Parquet va aborder la mesure », analyse l’avocat pénaliste Benjamin Grundler. Car, rappelle-t-il, « seul le Parquet peut en principe être à l’initiative d’une telle transaction ».
Aux États-Unis, la grande majorité des procédures pénales se règlent par la voie de la reconnaissance de culpabilité.
Non bis in idem : le casse-tête
Pour les entreprises concernées, la CJIP laisse entrevoir un espoir de taille : celui de sortir du joug des autorités américaines. Car si les tribunaux français n’ont jamais fait montre de beaucoup de sévérité à l’égard des sociétés poursuivies pour fraudes, leurs homologues outre-Atlantique sont réputés au contraire pour leur inflexibilité, ainsi que pour les montants extrêmement élevés des amendes qu’ils infligent. À titre d’exemple, Alstom a été condamné à 772 millions de dollars en 2014, tandis que la BNP écopait, un an plus tard, d’une sanction pécuniaire de 8,9 milliards de dollars.
Une question reste toutefois à trancher : celle de l’application du principe général du droit Non bis in idem, qui interdit à deux autorités de poursuivre une entité pour un même fait. « Ce principe n’a pas encore de reconnaissance transnationale en dehors de l’Union européenne », note Benjamin Grundler. Dans l’affaire Pétrole contre nourriture, le pétrolier suisse Vitol, mis en cause aux côtés de Total, l’a soulevé devant les juridictions françaises, invoquant le plea agreement signé avec les autorités américaines. Suivi par le tribunal de grande instance de Paris, l’argument de Vitol est écarté par la cour d’appel. « Les juges d’appel ont considéré que le principe n’avait pas lieu de s’appliquer en l’espèce en raison de la nature différente des poursuites engagées d’une part aux États-Unis et, d’autre part, en France, explique l’avocat pénaliste. De manière globale, il est évident que chaque État aura intérêt à respecter ce principe afin d’assurer une certaine sécurité juridique aux acteurs économiques. » Les juridictions nationales vont donc devoir se prononcer sur une règle commune afin d’articuler au mieux la mise en œuvre de leurs procédures respectives.
Accueil favorable
Malgré ces incertitudes, la convention est accueillie favorablement dans le monde des affaires, car les entreprises apprécient l’efficacité de cette mesure, plus en phase avec le temps du business. Si Benjamin Grundler n’anticipe pas une augmentation significative immédiate du nombre de dossiers de corruption internationale traités par le Parquet, il pense que les lanceurs d’alerte pourraient avoir un rôle plus important à jouer en France : « Aux États-Unis, une part très importante des dossiers qui donnent lieu à des transactions ont pour origine les lanceurs d’alerte. » Dans l’Hexagone, la culture juridique et d’entreprise est bien différente : le changement se fait lentement mais sûrement. En février 2017, un amendement faisait parler de lui : il réduisait à douze ans après la commission des délits le délai de prescription pénale des infractions occultes. « Ne pas pouvoir aller au-delà de douze ans, c’est extrêmement court, estime Éliane Houlette. Mais peut-être que cela poussera les lanceurs d’alerte à nous communiquer plus rapidement les faits. » Les autorités peuvent aussi espérer que les entreprises se dénoncent elles-mêmes. Une stratégie qu’elles pourraient être enclines à appliquer afin d’éviter des peines plus lourdes. Et qui, paradoxalement, contribuerait certainement à renforcer la place des institutions judiciaires françaises sur la scène internationale de la lutte anti-corruption.
FOCUS: le Parquet européen sort des cartons
Au début du mois d’avril, seize membres de l’Union européenne ont entériné la création d’un parquet européen, qui devrait être opérationnel à la mi-2020. Son rôle : lutter contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union. Concrètement, il prendra la forme d’un organe décentralisé intégré dans les systèmes judiciaires nationaux, et sera animé par un procureur européen ainsi qu’une équipe de procureurs délégués dans les États membres. Responsable devant le Conseil, le Parlement européens et les Parlements nationaux, le parquet aura pour objectif une certaine harmonisation des sanctions, mais aussi un renforcement de la lutte anti-fraude. Selon la Cour des comptes européenne, les fraudes transfrontalières à la TVA représentent entre quarante et soixante milliards d'euros de pertes annuelles de recettes. Elle estimait, en 2013, que le manque à gagner fiscal global dans l’Union se chiffrait à 168 milliards d’euros annuels – une raison de plus, s’il en fallait une, pour motiver la création d’un super-PNF européen.
Camille Prigent
[1] En prenant comme base de calcul les chiffres d’affaires de 2014, 2015 et 2016.