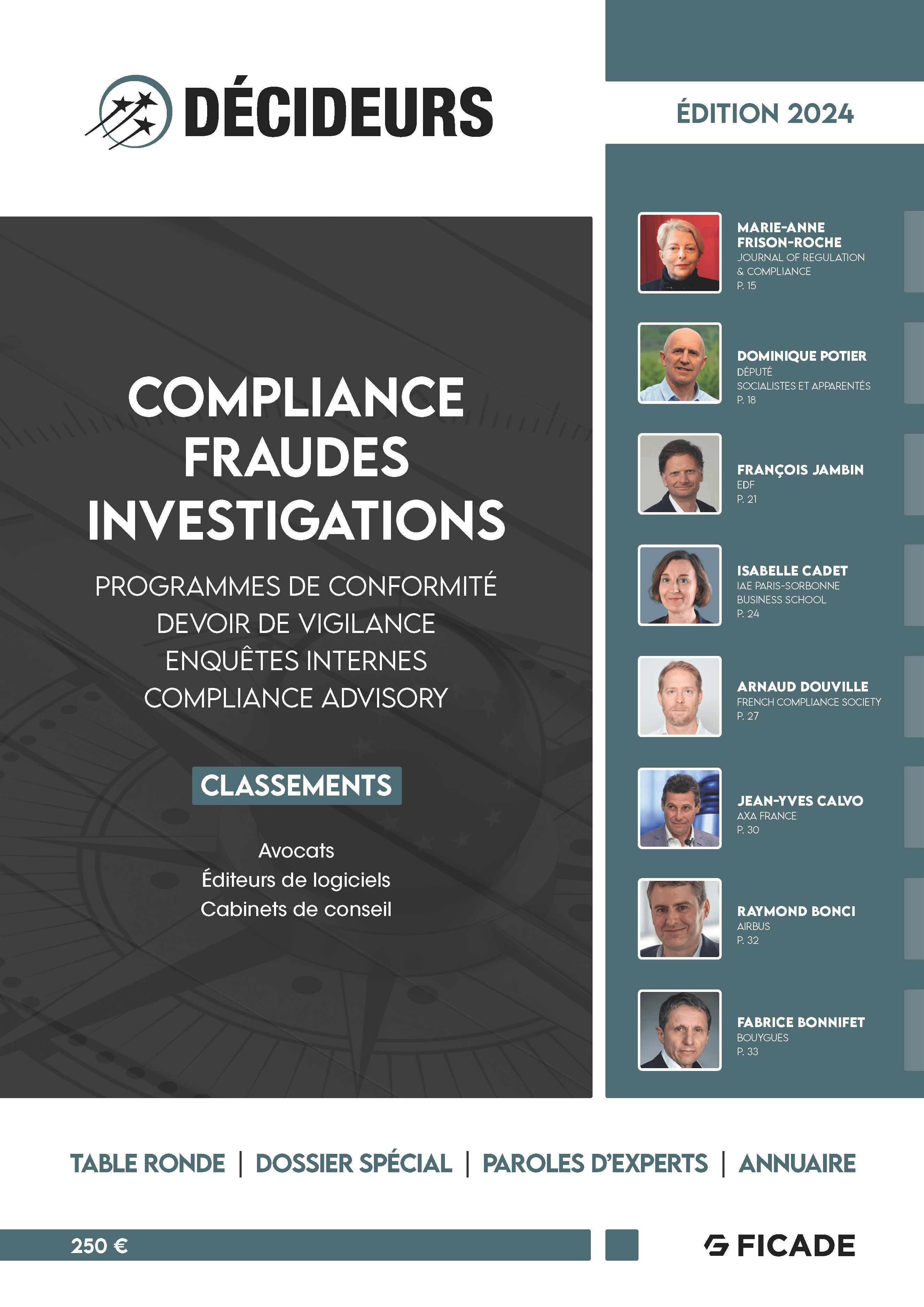Yann Alix (Ashurst) : « On observe une implication accrue des acteurs financiers chinois »
Décideurs. Quelles sont les grandes tendances du secteur minier et quelles précautions faut-il prendre selon vous dans les projets de M&A du secteur?
Yann Alix. Au cours du premier semestre 2016, l’activité de M&A dans le secteur du pétrole et du gaz a été morose, les compagnies pétrolières et gazières continuant de gérer et de s’adapter à l’univers du « nouveau prix normal » du pétrole inférieur à 50 dollars le baril. Les actifs d’exploration et les gisements en phase précoce ont été particulièrement affectés par la dégringolade des prix de l’or noir, le nombre limité d’acquéreurs présents sur le marché ciblant des transactions avantageuses sur des actifs de production de haute qualité. Ces douze derniers mois, quelques velléités de croissance ainsi que des signes positifs d’accroissement de l’activité de M&A semblent néanmoins se dessiner. Le marché continue d’être acheteur, mais ces acquéreurs semblent désireux de se procurer des actifs en phase de développement et de pré-développement.
L’activité de M&A en cours diffère dans certains cas de l’activité traditionnelle de M&A réalisée en amont. Nous assistons à des transactions plus structurées et l’on se fie de plus en plus à des arrangements innovants incluant des contreparties différées (parfois pour compenser les différentes attentes en matière de prix entre vendeurs et acheteurs) et, sur certains marchés, à un abandon, lors des transactions, de positions standards traditionnellement acceptées sur le marché (par exemple en liaison avec la prise en charge, par les acheteurs, de tous les passifs environnementaux et de déclassement accompagnant les actifs en train d’être vendus).
La croissance de l’activité de M&A a également conduit les investisseurs financiers, tout particulièrement les fonds de placement privés et les fonds d’infrastructure, à s’intéresser plus fortement à ce secteur industriel. Ces investisseurs ont souvent des moteurs de valeur différents, ce qui peut entraîner des changements dans l’attribution des risques transactionnels traditionnellement acceptés.
Dans les grands chantiers miniers, la volatilité politique et des prix des minéraux peuvent créer des tensions. Comment les clauses, notamment de médiation et d’arbitrage, peuvent être optimisées pour ré- soudre ces problèmes?
Il ne fait aucun doute que les tensions politiques et financières engendrées par une tarification imprévisible et des incertitudes politiques profondément enracinées constituent un problème particulier pour le secteur minier. La plus forte contribution qu’une clause d’arbitrage puisse livrer pour s’attaquer à ces tensions est qu’elle soit claire et efficace. Il est important que les parties sachent qu’en dernier ressort, si un litige surgit, ce sont leurs droits et obligations légaux qui dicteront l’issue juridique, et rien d’autre. Il est important aussi, toutefois, que la clause de résolution du litige au sens élargi soit structurée de sorte que les risques qu’un litige survienne réellement et qu’il faille recourir à tout l’instrumentaire d’arbitrage soient minimisés. Une façon d’y parvenir consiste à appliquer des clauses de remontée progressive, une autre à recourir à une médiation contraignante. Dans le secteur minier, les litiges ont ceci de particulier que l’État y joue bien souvent un rôle. À ce titre, nous trouvons que la médiation est parfois moins efficace vu la difficulté de trouver des médiateurs comprenant suffisamment dans le détail la dynamique politique qui sous-tend fréquemment ce processus. Il est fréquent que les États se comportent de façon assez diffé- rente avec les particuliers, et les médiateurs ne comprennent pas tous les défis spécifiques que la résolution d’un litige représente pour un État, notamment si le litige est politiquement controversé.
Avec les États, il est plus probable que des clauses de remontée différenciées soient efficaces, mais ceux qui les élaborent doivent faire leurs devoirs et comprendre, notamment lorsqu’un gouvernement est impliqué, qui pourra être le mieux à même d’éviter de facto le développement d’un conflit, ou de résoudre précocement un conflit naissant. Le choix du bon acteur pour jouer un tel rôle est influencé par les caractéristiques spécifiques d’un système particulier de gouvernement.
L’Afrique fait émerger des chambres d’arbitrage, quel regard portez-vous sur ces nouvelles institutions ?
L’un des domaines dans lequel on peut voir les avantages à comprendre comment sont vues les choses faites localement, est celui de la croissance des institutions d’arbitrage locales et régionales dans toute l’Afrique. Cela témoigne à la fois de la réussite de l’arbitrage international et, dans une certaine mesure, du défi potentiel que ces institutions repré- sentent, notamment pour les institutions mondiales historiques, qui ont promu la croissance de l’arbitrage international.
La réussite des grandes institutions d’arbitrage comme l’ICC, la LCIA et le SIAC réside de manière très significative dans le fait qu’elles sont internationalement reconnues pour leur indépendance et pour être imperméables aux prises d’influence ou interférences de l’exté- rieur. Le fait que les règles institutionnelles de ces organisations ont déjà fait leurs preuves revêt aussi une grande importance.
La croissance des institutions d’arbitrage ré- gionales en Afrique (et ailleurs) atteste certainement de la robustesse du processus de l’arbitrage international, mais les institutions en cours de développement sur l’ensemble du continent ne peuvent pas toutes être considérées objectivement comme à l’abri de l’influence gouvernementale ou comme possé- dant des règles qui permettent de prédire avec certitude quelle sera l’issue de l’interprétation ou de l’application d’une disposition spécifique. Il reste également à démontrer que les mécanismes de soutien administratif nécessaires sont en place et qu’ils sont, eux aussi, imperméables aux prises d’influence. Tant que ces facteurs ne seront pas démontrés avec un taux de confiance de 100 %, plusieurs utilisateurs potentiels émettront des réserves avant d’accepter de les utiliser.
Les prix du pétrole et des matières premières ont mis sous tension certains États. Comment les financements de projets déjà structurés ont-ils absorbé cette volatilité ?
L’énergie est un thème d’actualité récurrent associé au développement économique de l’Afrique. D’une part, les vastes ressources pétrolières et minérales de l’Afrique (ainsi que ses ressources renouvelables) ont été bien documentées. D’autre part, le manque d’accès à l’énergie – à des sources d’électricité fiables, sûres et durables – a entravé l’aptitude du continent à développer un modèle socio-économique efficace et harmonieux.
Les institutions internationales, les gouvernements et d’autres acteurs sur le marché ont reconnu son rôle critique. Si les frais de capitaux liés à certaines technologies (par exemple l’énergie solaire photovoltaïque) ont radicalement diminué, l’accès à un financement compétitif et abordable demeure un obstacle difficile à franchir, en particulier à la lumière de l’environnement local (par exemple les risques politiques liés au pays ou le cadre juridique et légal) qui peut varier selon le pays d’accueil et semer ainsi le doute quant à la faisabilité bancaire des projets relatifs à l’électricité.
Ce n’est donc pas une surprise si la Banque africaine de développement met l’accent, parmi ses cinq priorités sur la capacité à « éclairer l’Afrique et à y installer l’électricité ». La Banque africaine de développement joue, aux côtés de la Banque mondiale et d’autres institutions financières internationales, un rôle clé lui permettant de financer les projets d’électricité dans toute l’Afrique. La réussite du secteur solaire au Maroc illustre bien la nature transformationnelle du secteur rendue possible par le soutien d’institutions financières internationales sous forme de prêts concessionnels et de subventions, de prêts innovants et de structures de prélèvement d’électricité.
Parallèlement à ces institutions internationales, il convient de souligner l’implication accrue des acteurs financiers chinois ces dernières années (dont la Banque de développement de Chine et la Banque chinoise d’import-export [Banque Exim]), en particulier dans des projets hydroélectriques (notamment en Zambie, en Angola et au Cameroun). Appuyés par des sources de financement chinoises compétitives, des sponsors et fournisseurs de technologies chinois ont les moyens de proposer des tarifs attractifs qui, tout en étant les bienvenus dans les pays d’accueil, peuvent susciter un certain scepticisme chez les promoteurs privés internationaux et africains.
Ces derniers jouent un rôle important dans l’électrification de l’Afrique, mais leur appétit se cantonne principalement à la production d’électricité. Les réseaux de transport et de distribution exigent, dans de nombreux pays, une mise à niveau et/ou un développement substantiel(s), donc de volumineux investissements publics. Il est donc nécessaire que la dépense publique des pays africains dans le secteur de l’électricité continue d’augmenter. Au regard du climat économique actuel, ce ne sera pas tâche facile. Il faudrait envisager des solutions alternatives telles que le potentiel de développement hors réseau ou de réseaux locaux associant des projets solaires et éoliens avec un stockage en batterie, pour réduire les investissements de capitaux dans des réseaux nationaux.