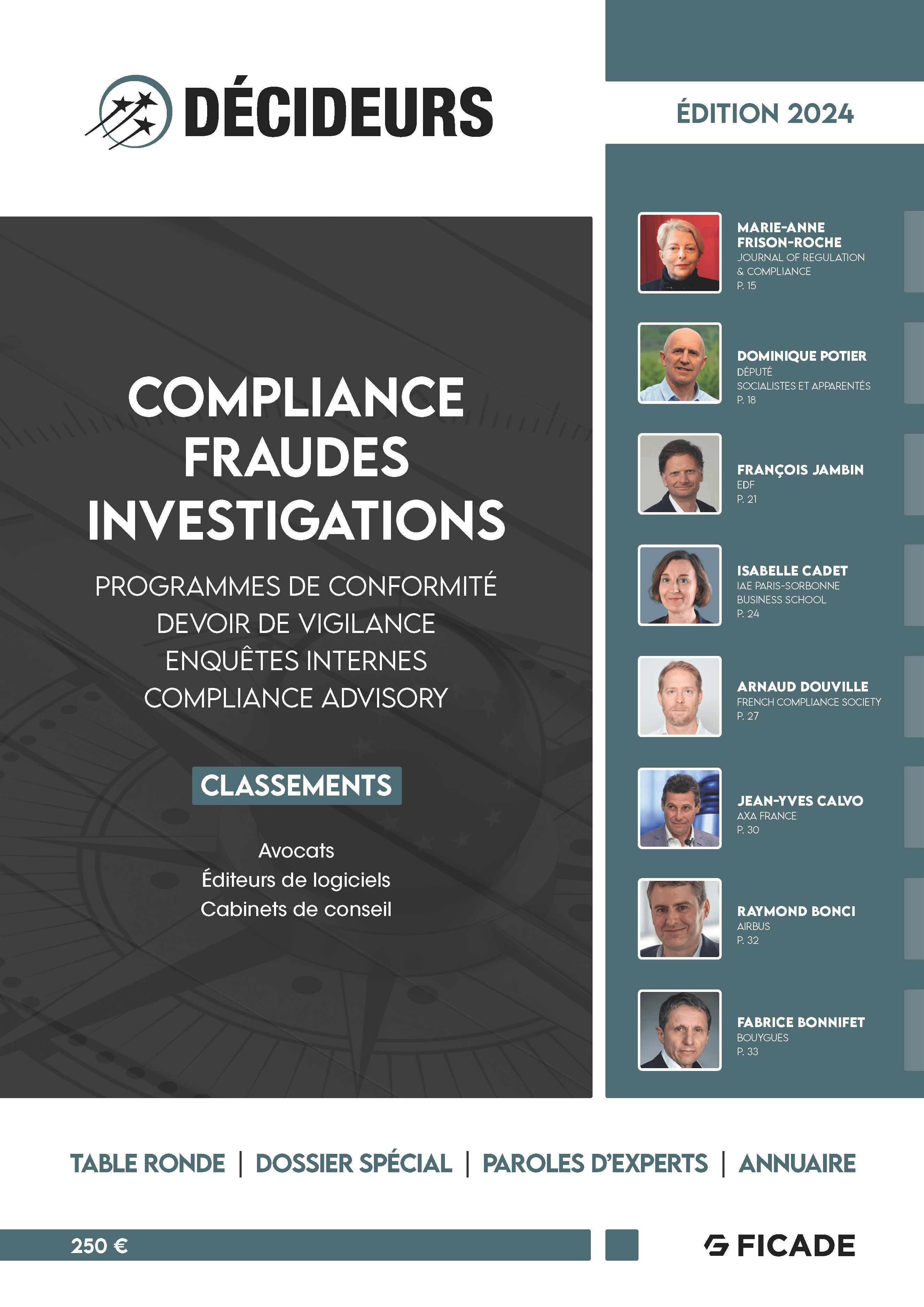Co-emploi et responsabilité délictuelle : une sécurisation et des questions
Par Pierre-Alexis Dumont et Loïc Touranchet, avocats associés. Cabinet Actance
La Cour de cassation, en créant la notion de co-emploi en dehors de tout lien de subordination, avait sans le vouloir ouvert la boîte de Pandore.
Au sein de groupes de sociétés où l’état de domination économique est la norme, tout comme l’existence de coordination des activités économiques, la démonstration de l’existence de la triple confusion d’intérêts, d’activité et de direction était relativement aisée.
Les conséquences pour le groupe en cas de licenciements économiques prononcés au sein d’une filiale française étaient significatives : la reconnaissance du co-emploi entraînait la condamnation de la société mère ou toute autre société du groupe reconnue comme le véritable employeur à des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant saisi la juridiction prud’homale. Une telle solution était surtout opportune lorsque la filiale en question était sous le coup d’une procédure judiciaire ; une fois la triple confusion démontrée, les salariés faisaient ainsi coup double : ils trouvaient dans une autre société du groupe, à la fois un responsable et un payeur.
Le désormais fameux arrêt Molex de juillet 2014(2), en exigeant, au-delà de la caractérisation de la triple confusion précitée, une immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale, c’est-à-dire une ingérence anormale, a marqué un véritable coup d’arrêt, au-delà de ce qu’on pouvait raisonnablement anticiper.
Une réelle sécurisation juridique pour les groupes, en particulier en cas de procédure collective
Dans nombre d’affaires, le co-emploi reste en effet sollicité de pure forme, les salariés misant davantage sur la condamnation de la société mère demandée à titre subsidiaire sur le terrain de la responsabilité délictuelle, quand ils n’abandonnent pas carrément leurs demandes principales au titre du co-emploi en cours de procédure.
Cette sécurisation est évidemment une excellente nouvelle pour les groupes, particulièrement les groupes étrangers, dont la filiale ou une filiale française subissait des difficultés telles qu’un dépôt de bilan était inévitable.
Ces groupes comprenaient et vivaient assez mal le fait qu’ils puissent être astreints devant le juge français du contrat de travail à travers la société mère de l’employeur français, par des salariés qui n’étaient pas les siens et lui réclamaient des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De surcroît, à cette sécurisation « aval » issue de la jurisprudence de 2014, s’est ajoutée une sécurisation « amont » issue de la loi en 2015. En effet, ces mêmes groupes devaient, après avoir souvent perdu beaucoup d’argent en finançant une société exsangue, financer le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) au motif qu’ils étaient eux-mêmes bien portants et que le contenu de ce PSE était apprécié au regard de leurs propres moyens. La loi Macron du 17 août 2015(3) a mis un terme à cette situation en distinguant les entreprises en redressement ou en liquidation, des entreprises in bonis ; le contenu du PSE doit désormais pour les premières citées être apprécié par l’administration uniquement « au regard des moyens dont dispose l’entreprise ». Les décisions d’homologation sont désormais elles aussi grandement sécurisées, les recours par les salariés et/ou leurs représentants devant les juridictions administratives étant, sur le fondement de la proportionnalité, quasiment vouées à l’échec.
Cette sécurisation juridique rejoint la volonté politique affichée au cours des dernières années de rassurer les investisseurs, principalement étrangers, sur les conséquences juridiques et financières de leurs investissements en cas d’échec.
L’article 1240 du code civil : une réelle alternative ?
Dans deux arrêts de la chambre sociale du 8 juillet 2014(4), soit quelques jours après le coup d’arrêt porté au contentieux relatif au co-emploi, la Cour de cassation a rappelé aux salariés qu’ils avaient la possibilité de solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de fautes commises par une société du groupe et ayant conduit à leurs licenciements.
De telles fautes, lorsqu’elles ont concouru à la « déconfiture » de la filiale et par conséquent, à la conduite de licenciements pour motif économique, peuvent alors faire l’objet d’une réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Cependant, une telle mise en cause sur ce fondement est assurément plus délicate que la seule reconnaissance d’une situation de co-emploi lorsque la triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction était suffisante pour entraîner la requalification des licenciements prononcés en licenciements sans cause. À cette difficulté probatoire s’ajoute la difficulté consistant à chiffrer le préjudice, sur un terrain civiliste mal maîtrisé par les praticiens du droit social, en dehors des sentiers prud’homaux balisés (barèmes indicatifs et bientôt imposés). L’étude des précédents en la matière (condamnations uniformes d’un montant limité), montre d’ailleurs que cette voie n’est pas forcément satisfaisante pour les salariés.
Quel juge compétent ?
Une autre difficulté de taille apparaît dans le cadre de ce contentieux, puisque le terrain choisi est celui de la responsabilité extra-contractuelle : le conseil de prud’hommes, juge du contrat de travail, est-il alors compétent ?
La fonction principale dudit conseil est de régler amiablement ou juger les différents ou litiges « qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail ». Pour cette raison, de nombreux juges du fond se sont prononcés par la négative sur cette question : un nombre important de conseils de prud’hommes, mais également plusieurs chambres sociales de cours d’appel, qui se sont récemment déclarées incompétentes pour statuer sur les demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle d’une société mère (au sens large), en particulier la cour d’appel de Rennes le 20 avril 2016(5) et la cour d’appel de Caen le 13 janvier 2017(6) dans les affaires Comareg, ainsi que la cour d’appel de Riom dans l’affaire Platinum Equity le 27 septembre 2016(7).
Une difficulté supplémentaire se pose en cas de restructuration menée dans une entreprise qui n’est pas in bonis : l’incompétence matérielle devant être prononcée au profit d’une autre juridiction, reste à savoir s’il s’agit du TGI ou du tribunal de commerce. Rappelons en effet que, en vertu des dispositions du code de commerce8, le tribunal de commerce saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît « de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et liquidation judiciaire (…) », l’action en responsabilité civile de la société mère ne figurant pas au nombre des exceptions visées par ce même texte. On peut légitimement penser, comme l’ont d’ailleurs déjà reconnu certains tribunaux, qu’une telle action doive être menée devant le tribunal de commerce.
Dans l’attente d’une position de la Cour de cassation sur ce point, c’est en tout cas un casse-tête judiciaire qui s’offre aux praticiens et à leurs clients, entreprises et salariés.
(1) Loi n°2013-504 du 14 juin 2013
(2) Cass. Soc., 2 juillet 2014, 13-15.208
(3) Article L.1233-58-II du Code du travail
(4) n°13-15.573 et 13-15.470
(5) N°14/00071 et 14/000186
(6) N°16/01179
(7) N°15/03239 et autres
(8) Article R.662-3